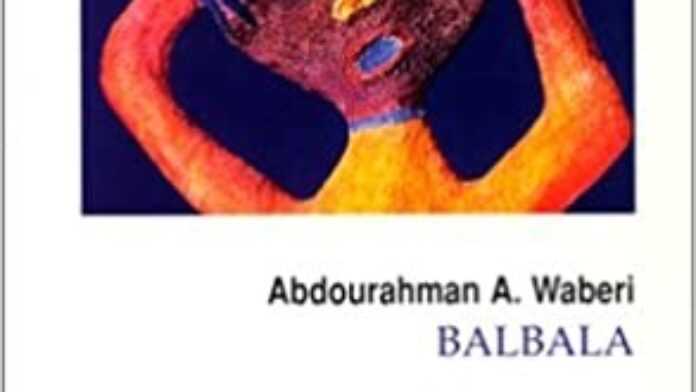
Il faut relire » Balbala « , d’Abdourahman A. Waberi, roman en quatre volets sur Djibouti qui a obtenu le Grand Prix de l’Afrique noire en 1996. Le livre est là, proliférant, juste comme un réquisitoire et joyeux comme un morceau de vie, avec ses personnages qui vont au bout d’eux mêmes, de leurs convictions et de leurs passions.
Waberi sait dire avec fureur et vérité la sécheresse, qui à nouveau sévit dans la Corne de l’Afrique, et ses conséquences. Il sait parler du drame tel qu’il se vit : abandon du ciel, fatalité de la mort, aggravation tenace de la souffrance : » La plus terne des étoiles brille sur le pays ; la plus inconsolable vient nous éclairer et l’enfer ici durera une petite éternité tandis que d’autres paniquent et se font un mauvais sang de tous les diables à cause d’une demi-saison satanique. La contrée tète un breuvage couleur de pus depuis que les nuages ont entamé leur bouderie. L’eau a disparu pour retrouver sa liberté sans borne. Elle a déserté les nappes phréatiques pour quelque destination inconnue… L’eau nous est plus inatteignable que les souvenirs d’enfants à jamais perdus. »
Face à cela, à ce malheur et à cet abandon, Waberi sait dire le grotesque des politiques : » Il est parti dans le brouillard de poussière soulevé par la noria de véhicules -des Pajero 4×4 toutes de chromes rutilantes -tellement égarée dans ce douar perdu de la République qu’on eût dit une famille de pécheurs yéménites escaladant les flancs enneigés du Kilimandjaro… » Car les hommes de pouvoir nourrissent encore des ambitions, qui contribuent à ruiner encore un peu plus la région : » La Corne : des bases militaires en croissance, des contreforts vides de vivres, des mythes ravageurs comme la Grande Somalie, la Grande Afarie ou la Grande Ethiopie, des lâchetés diplomatiques, la ronde des malheurs, la terre qui se câbre et se convulse, le ciel qui boude et la mer qui pue… La Corne : des mercenaires en faction, des légionnaires en mouvement, des indigènes en guenilles, des guérilleros en embuscade, des troupeaux en sursis, la terre en ébullition, la mort à huis clos comme à Baidhoba… »
Mais la dénonciation et la colère ne suffisent pas à décrire ce monde : il porte en lui aussi les étincelles de vie qui peuvent le transfigurer, et l’écrivain sait y donner forme verbale. Ainsi de sa définition du nomade, qui face à la dureté du monde se trouve perpétuellement en devenir, et peut y puiser sa ressource : » Le nomade est à l’inverse de l’arbre, il s’enracine par ses fruits, c’est-à-dire par ce qu’il fait de sa vie tourbillonnante. Chez lui règne la poésie du récif ocre ponctué par des touffes de vert ; il se fait chasseur d’images rares, caravanier de mots et de joutes verbales. Souvent il se trouve naufragé dans le présent : un abri temporaire, un no man’s time où il se sent inexplicablement aux aguets. »
Est-ce dans cette liberté du nomade que les quatre principaux personnages de ce roman bouleversant puisent leur énergie et leur force d’affirmation ? L’athlète lauréat des jeux olympiques, le médecin du bidonville de Djibouti, le fonctionnaire qui est aussi un peu poète, sa soeur, femme fleur poussée dans ces décombres ? Balbala est un roman tonifiant, optimiste, fécond. Même si » ce qui se dit facilement se vit difficilement « , malgré les arrestations, les souffrances, les injustices. Le livre se ferme sur une leçon de vie, celle que proclame Anab : » un cristal pur comme une larme de tendresse. » Contre la dictature du malheur, » elle fait grande provision d’espoir, s’arme de patience en attendant les lendemains qui chantent haut et fort. Si l’occasion s’en présentait, elle n’hésiterait pas à passer derrière la caméra pour raconter le film de sa vie, ses joies comme ses peines, ses glissements comme ses ébahissements, ses amours comme ses solitudes… » Chiche ? Le roman mériterait en effet de se faire film…
Commander Balbala.
Lire aussi :




