
Une belle histoire que cette publication ! Hammam et Beaujolais, l’ouvrage de Nadia Khouri-Dagher, vient de paraître aux éditions Zellige après avoir été diffusé sur notre site sous le titre de L’apprentissage.
Plus de 150 000 internautes ont parcouru les chroniques de la journaliste franco-libanaise, de juillet 2006 à janvier 2008. Un formidable succès que vient couronner l’édition papier du livre au cœur duquel se trouve une réflexion sur les thèmes de l’exil, de l’appartenance et du racisme. Pour clore cette aventure, l’auteur offre en exclusivité aux lecteurs d’Afrik.com un texte inédit : l’épilogue de son abécédaire.
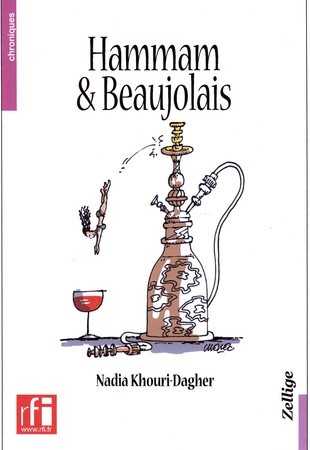 Nadia Khouri-Dagher, née en Egypte de parents libanais, vit aujourd’hui en France. Un pays dont elle s’est appropriée la culture, mais sans tourner le dos à celle de ses origines. Avec humour et sagacité elle pratique l’introspection, observe ses concitoyens, explore les thématiques du déracinement, de l’exil, et la manière dont la France « intègre » les migrants et leurs enfants. De A comme Accent à Z comme Zut, elle égraine dans Hamam et Beaujolais près d’une centaine de mots grâce auxquels l’on découvre une autre façon de voir la France et d’être français, une invitation à conjuguer l’identité au pluriel. Nadia Khouri-Dagher, née en Egypte de parents libanais, vit aujourd’hui en France. Un pays dont elle s’est appropriée la culture, mais sans tourner le dos à celle de ses origines. Avec humour et sagacité elle pratique l’introspection, observe ses concitoyens, explore les thématiques du déracinement, de l’exil, et la manière dont la France « intègre » les migrants et leurs enfants. De A comme Accent à Z comme Zut, elle égraine dans Hamam et Beaujolais près d’une centaine de mots grâce auxquels l’on découvre une autre façon de voir la France et d’être français, une invitation à conjuguer l’identité au pluriel. |
Epilogue
Les voyageurs et explorateurs de jadis étaient surtout des hommes.
Célibataires, ils ne l’étaient pas forcément, mais presque toujours le temps du voyage et de leurs explorations, qui duraient des mois, voire des années : en bateau on avance lentement pour parcourir le monde.
Ceux qui ont le plus écrit sur les peuplades lointaines, rapportant des descriptions de leurs mœurs et coutumes, de leurs manières de vivre et de penser, étaient donc dans leur majorité des hommes, blancs, venus d’Europe, et décrivant, pour un public d’Occident, les mœurs – étranges forcément, puisque différentes – des peuples rencontrés sur les autres continents.
En outre, et d’autres l’ont dit abondamment, ces voyageurs étaient souvent liés à des missions d’exploration qui étaient aussi des missions de conquête, préludes aux colonisations et soumissions qui suivirent. Il fallait donc montrer non seulement que l’autre était différent, mais qu’il était inférieur: en civilisation, en humanité.
Les seuls à s’opposer à cette vision hiérarchique des êtres humains furent souvent, au cours des siècles passés, des hommes de religion, jésuites défendant que les Indiens d’Amazonie aussi avaient une âme humaine, pères blancs immergés dans les jungles d’Afrique pour vivre auprès de populations noires que d’autres considéraient comme sauvages parce qu’ils vivaient nus.
C’était bien avant les années hippies et le rejet du modèle occidental bourgeois et conquérant, bien avant Woodstock où des couples vécurent nus plusieurs journées entières, bien avant les années 1980 et la mode des seins nus sur les plages de France, bien avant les années 2000 et la mode du string qui donne à voir en Europe les slips – et parfois même les fesses – des femmes dans la rue, c’était bien avant que les magazines féminins – et non seulement masculins – mettent en couverture des stars de cinéma vêtues d’une simple culotte : en ce temps-là, le nu était barbare, seul l’Occident était civilisé.
La musique de ces peuples lointains était barbare aussi : des tam-tams, quel raffût ! Aucune comparaison avec ce noble Mozart, avec ce très cher Bach. Lorsque Ray Charles, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin commencèrent à chanter, faisant découvrir au monde entier l’extraordinaire beauté et puissance d’émotion des voix noires, lorsque le jazz naquit, qui devait bouleverser toute l’histoire de la musique mondiale en lui donnant ce rythme et cette énergie qui nous sont essentiels aujourd’hui, aux Etats-Unis blancs et noirs vivaient ségrégés – je veux dire plus encore qu’aujourd’hui : le mélange était interdit par la loi, dans les cafés, les restaurants, les quartiers d’habitation, no blacks no dogs please.
C’était bien avant la consécration mondiale de Michael Jackson, Beyoncé, ou Manu Dibango. C’était bien avant Elvis Presley et les Beatles, bien avant les années 60, le rock and roll et l’introduction dans la musique populaire occidentale de la batterie, héritière directe des tam-tams africains, et d’une rythmique forte venue aussi d’Afrique – parfois via les Caraïbes. C’était bien avant le succès planétaire de Buena Vista Social Club, ces métis créoles.
La musique que les gens aiment, les chansons qu’ils aiment chanter, représentent, en tous lieux, l’une des parts les plus intimes, les plus « authentiques » d’une culture : outre les objets, c’est aussi les musiques et les chants des peuplades lointaines que les ethnologues enregistrèrent avec passion jadis, conscients qu’une musique partagée et aimée par un peuple le définit autant que ses vêtements, son habitat, ses objets du quotidien, ou ses rituels religieux.
Aujourd’hui, la musique populaire de France, d’Europe, et de tout l’Occident, est métissée d’Afrique, de Caraïbes, d’Orient aussi, et bientôt de Chine pourquoi pas. Bernard Lavilliers est-il moins français de chanter sur un rythme de reggae, Maxime le Forestier sur une biguine? Et que dire de Jane Birkin l’Anglaise qui chante en français sur des rythmes d’Orient?
Depuis la nuit des temps les cultures se marient harmonieusement, la musique en est le vibrant témoignage, malgré tous les désirs de guerre des puissants. Emprunts, voyages, métissages vieux comme le monde, Moïse changeant de pays déjà, Noé partant loin sur son bateau, poteries de Sienne retrouvées à Athènes, soieries de Chine portées par de belles Vénitiennes, café d’Amérique Latine devenu bien de nécessité en Occident. Le voyage fonde la condition humaine, depuis toujours les peuples ont bougé, migré, cherchant là une terre plus fertile, ici un abri plus sûr pour leurs petits pour fuir une oppression, au total empruntant aux uns et aux autres leurs us et coutumes. Les archéologues, jusque dans la préhistoire, ont de ceci les preuves scientifiques.
Il y a quelques années, une exposition au Musée de l’Homme avait comme thème la cuisine. Y étaient présentés des outils culinaires du monde entier: cuillères, marmites, râpes, chaudrons, couteaux, …. Je passai de longues heures, allant de vitrine en vitrine, car rien ne me plaît plus, dans les peuples que je ne connais pas, que ces objets du quotidien, ordinaires, chargés d’émotion bien plus que les couronnes et joyaux des rois, car ils ont été réalisés et utilisés des années, sinon avec amour, du moins avec une attention extrême, comme nous utilisons nos jolis verres, nos bijoux, ou nos beaux stylos, qui sont un peu de nous. A la vue de ces objets du quotidien, je peux parfaitement imaginer les gestes accomplis par ces peuples, d’aujourd’hui ou d’hier, que je ne connais pas.
Dans cette exposition, j’eus soudain la révélation de l’étonnante UNITE de tous les peuples du monde, malgré tous les discours entendus, tous les livres écrits, tous les dessins et gravures de nègres sans chemise, d’indiennes à poil dans la forêt, ou de femmes chinoises souffrant les pieds bandés. Car il n’y a pas mille manières de tourner une cuillère en bois dans un liquide qui bout, pas mille manières de couper que de trancher avec une lame, pas mille manières de piler qu’avec un pilon, pas mille manières de tamiser que de passer à travers un tamis. J’eus soudain cette pensée-éclair:
Toutes les femmes du monde font les mêmes gestes pour faire la cuisine
La commissaire de cette exposition sur la cuisine était une femme. Et je réalisai à quel point la vision féminine des choses pouvait faire beaucoup pour rapprocher les peuples. Non pas parce que les femmes sont moins violentes que les hommes. Mais parce que, depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui ont la charge du quotidien, sur toute la planète: parce que ce sont elles qui portent les enfants et ont ainsi la charge de les faire grandir et d’en assurer la protection – regardez donc chez les animaux, c’est un peu la même chose.
Or partout sur la planète pour un humain la gestion du quotidien, ce que l’on nomme aujourd’hui la vie de famille, malgré ses modes divers ici et là, est plus ou moins la même : préparer à manger aux enfants, leur apprendre à parler, et à rire aussi, les gronder s’ils font des bêtises, nettoyer la maison, la décorer, éplucher des légumes, laver le linge, étendre le linge, rapporter l’eau de la fontaine, donner un bain à ses enfants,…
Bien sûr, on pourrait dire la même chose des hommes, qui partout sur la planète, pour se nourrir, ont chassé, pêché, fait du feu pour faire cuire des bêtes, construit des maisons pour y mettre leur(s) femme(s) et leurs enfants ou même, construit des villes, des routes, fabriqué des selles pour leurs chevaux, des roues pour leurs carrioles, des bateaux et navires étanches et costauds pour leurs longs et aventureux voyages…
Mais voilà, l’Histoire écrite par les hommes, jusqu’à un temps récent, s’intéressait moins à tout ce qui rapproche les humains qu’à ce qui les divise, et c’est ainsi qu’à l’école nous apprîmes la liste de tous les Rois de France, le nom de toutes les batailles livrées contre les ennemis, 1515 Marignan, les Arabes arrêtés à Poitiers, les Anglais vainqueurs à Waterloo.
Pourtant, partout au monde, ce sont les mêmes joies et les mêmes douleurs que l’on éprouve, que l’on soit homme ou femme, à la naissance d’un enfant, quand on est amoureux, lorsque meurt une personne aimée, lorsque l’on guérit d’une maladie, et tout ce qui fait la vie des hommes, des femmes, et des enfants, depuis la nuit des temps.
Familles je vous aime, car vous me rappelez que je suis chez moi partout, appartenant à la vaste famille des hommes, et non à un pays, ou à un continent.
Aïn-Draham, mars 1992 – Paris, février 2008
Lire aussi : l’interview de Nadia Khouri-Dagher




