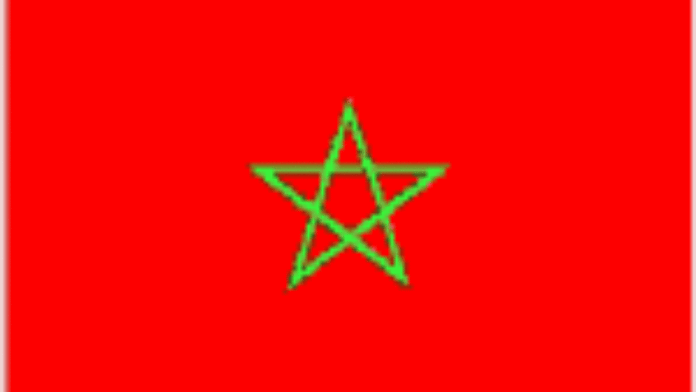
Au Maroc, les écrivains publics ont du mal à joindre les deux bouts. Les clients se font de plus en plus rares. Ils sont concurrencés par l’outil informatique et les nouveaux ne peuvent obtenir des autorisations qui se transmettent de père en fils. Ceux qui travaillent encore doivent composer au milieu des effluves d’urine et la poussière dégagée par les travaux de la muraille de Bab Al Had…
De notre partenaire L’Economiste
Bab Al Had, à Rabat. Le passage est emprunté par les piétons, les voitures… A 14h30, ce lundi, il fait chaud et les passants sont rares. Les écrivains publics sont déjà là devant leurs machines à écrire. Ils attendent le client. Quatre d’entre eux ont placé leurs tables à l’ombre contre le mur. Huit autres sont en plein soleil, protégés par leurs parasols. « J’exerce ce métier depuis une dizaine d’années. Je suis assistant. » Le teint basané, une cicatrice à la joue droite, Hamid porte un jogging bleu et des baskets.
Il parle en fixant un point imaginaire et explique : « J’écris dans trois langues : le français, l’anglais et l’arabe. J’ai un baccalauréat ». La trentaine, Hamid est confortablement installé dans un fauteuil rouge recouvert par un plastique bleu. Sur une table qui a connu des jours meilleurs, sont disposées deux machines à écrire, un verre de thé sous un papier et un pinceau rouge. Dans le tiroir entrouvert, cinq enveloppes jaunes et du papier attendent d’être utilisés. « Ces machines, je me les suis débrouillées chez un ami. Il les a eues en contrepartie de travaux menés pour le compte d’un avocat. »
De pères en fils
Un nuage de poussière envahit la place. Il provient des travaux d’entretien de la célèbre muraille: « On en a plein les yeux et la bouche de cette poussière. Nous avons beau protester, c’est sans résultat ». Hamid met une petite radio en marche et baisse la tête pour rouler une cigarette. Il confie un peu hésitant : « Je partage mes gains avec le détenteur de l’autorisation, qui s’hérite. Les premières autorisations ont été délivrées du temps de Moulay El Hassan Al Awal ». Il explique qu’au départ, la place était réservée aux « talbas », ceux qui connaissent le coran par cœur. Les plus lettrés d’entre eux se sont convertis par la suite au métier d’écrivain public.
« Cette carte prouve que je suis écrivain public. Elle m’a été délivrée du temps de Feu Mohamed V. » Juste derrière Hamid, adossé à un mur, El Haj, septuagénaire en djellaba, les pieds dans des chaussettes bleues posées sur ses babouches. Il glisse sa main sous sa djellaba et sort fièrement une carte enveloppée dans un plastique violet. Ce personnage hors du temps contraste avec le décor. Une caisse en bois lui fait office de table. Juste à côté, une canne et un tabouret noir en plastique pour les clients. Difficile de lire ce qu’il écrit. Il est peut-être le seul à pouvoir le faire. Il se lance dans un historique de la profession. Son débit est rapide, au point qu’il en devient incompréhensible. Des bribes de conversation de son voisin avec une cliente couvrent maintenant la voix d’El Haj. Habillé également en djellaba, cet écrivain public prend des notes pendant que sa cliente expose son problème. Elle lui montre des papiers puis les remet dans un sachet en plastique et poursuit sa conversation à voix basse.
Tuer l’ennui
Pour tuer l’ennui, les autres écrivains s’occupent en grillant une cigarette ou en se passant un journal en arabe. L’un d’entre eux, Abdellah, regarde de temps à autre sa montre tout en jouant avec un trousseau de clés. Son père était également écrivain public. « Sa place » est occupée par un de ses frères. « Je ne maîtrise que la langue arabe. Quand je reçois un client qui veut rédiger un document en français, je l’oriente vers un collègue. » Timide, Abdellah parle à voix basse. « L’informatique est notre principal concurrent », affirme-t-il.
Devant lui, deux machines à écrire et un verre de thé vide. Il écrase sa cigarette par terre. L’odeur de l’urine est de plus en plus insupportable. « Chaque matin, nous lavons cet endroit, mais les odeurs persistent. La nuit, comme la place n’est pas éclairée, des passants en profitent… » Il s’arrête. Son regard est attiré par un client qui se dirige vers Hamza. Ce dernier éteint sa radio, sort du papier et se met devant sa machine. Il penche la tête et se concentre sur son client. Une manière de signifier qu’il ne veut pas être dérangé : le client se fait rare.
Par Khadija Masmoudi




