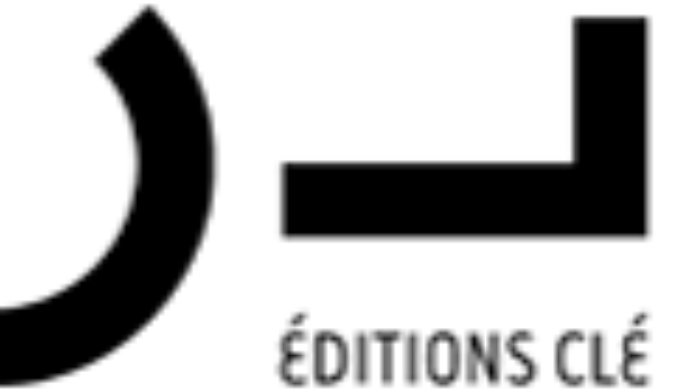
Charles Ateba Eyene a décidément la langue trop pendue. Il a le don de déranger. C’est un enfant ignorant, de la bouche duquel sortent tant de vérités. Le mercredi 26 septembre 2012, dans notre fameux hôtel Hilton, il était invité à un échange sur « l’avenir » du livre. Il a profité de cette tribune pour dresser un réquisitoire cru contre les éditions Clé, contre ce qu’elles sont devenues.
La vérité a blessé, les non-sens ont coulé
En réaction, le directeur des éditions Clé, sans condescendre à nommer l’auteur des « paradoxes du pays organisateur », l’a traité d’inculte, en donnant lui-même au passage quelques cours d’inculture à l’assistance, qui n’en demandait pas tant. Si Marcellin Vounda Etoa était une plume extraordinaire, cela se saurait. Marcelin Vounda Etoa s’est permis de narguer les auteurs qui viennent le voir, avec « des manuscrits sous le bras », convaincus de leur talent. Huit fois sur dix, ceux qui écrivent ont en effet un talent, mais en raison de l’environnement que des éditeurs vénaux instaurent, jamais on ne verra s’éclore tout ce potentiel. En raison des Marcellin Vounda Etoa, notre littérature se meurt.
Marcellin Vounda Etoa, nouveau maitre de l’esbroufe, a déclaré que les éditions clé sont « le premier éditeur africain » : la publicité mensongère que voilà, elle est d’ailleurs prévue et réprimée par les lois en vigueur. Franchement! L’édition en Afrique ne va pas si mal que l’on puisse dire de cette « association déclarée d’utilité publique », mais dont pas grand monde au Cameroun ne perçoit l’utilité, qu’elle est première en quoi que ce soit. A l’échelle nationale, il y a longtemps que les éditions Clé passent pour n’être que ce que Charles Ateba Eyene en a dit : une écurie de chenapans.
Pour établir les performances de sa structure, le directeur des éditions Clés a exhumé de grands noms comme Henri Lopes ou Sony Labou Tansi… Sont-ils inégalables ? En quoi, s’il vous plait ? S’ils le sont, pourquoi sont-ils inégalés ? C’est précisément parce que des éditeurs comme Marcellin Vounda Etoa opèrent aujourd’hui en purs fossoyeurs de la littérature. Les éditions Clé, quand elles publiaient Armand Claude Abanda ou Charles Ateba Eyene, les voyaient-elles comme de nouveaux Lopes ou est-ce l’appât du gain qui les aveuglait ?
La maison d’édition dont on parle est présentée par certains auteurs comme une association dont les sociétaires, ou ceux qu’ils emploient, rançonnent les auteurs : non seulement ceux qu’ils ont accepté d’éditer mais surtout les téméraires qui vont encore leur soumettre des manuscrits. Noah Parfait, concepteur-rédacteur dans une agence de communication à Douala (Ocean Ogilvy), ainsi que d’autres, sont prêts à témoigner à visage découvert de ce que de l’argent leur a été exigé pour un simple dépôt de manuscrit aux éditions Clé.
Ecrivain non diplômé en écriture
Aujourd’hui, le Cameroun produit des Charles Ateba Eyene, c’est ce que peut notre pays. Et nul ne peut dire la postérité qu’auront ses « œuvres ». D’ailleurs la postérité n’est pas le seul enjeu ni forcément la préoccupation majeure de tout auteur. Charles Ateba Eyene n’est pas mon camarade et je n’en veux pas comme ami, pourtant il faut lui reconnaître cette place qu’il occupe sans usurper, sans même la revendiquer, d’écrivain camerounais. Il écrit pour être lu et il est lu. Les universitaires cultivés, publiés par Marcellin Vounda Etoa, ne sont, eux, pas lus de leur vivant, rien ne dit que demain la postérité rendra justice à leur science.
Depuis le temps que nous avons des « génies », nous peinons à voir leurs productions. Les surdoués ne nous apportent pas grand-chose, nous voulons des forceurs, des auteurs laborieux, des gens qui travaillent, des petits Zola, des Flaubert tropicaux, et Charles Ateba Eyene travaille : j’achèterais volontiers toutes ses publications à venir pour les présenter à ma fille comme le produit d’un contexte, des livres qui la renseigneront sur son pays bien davantage que n’importe quel autre « livre scolaire ». Que la culture des éditeurs cesse d’être une culture du mépris des auteurs.
Léon Bloy et d’autres avaient, en leur temps, abondamment moqué Emile Zola, cet écrivain « inculte » qui n’avait même pas le baccalauréat. Combien sont-ils de nos jours à se souvenir que Léon Bloy avait des qualités d’écriture bien plus étincelantes que celles de l’auteur de L’Assomoir ? La maîtrise de l’orthographe n’est pas une qualité nécessaire à l’écrivain, le style même peut être plat (Annie Ernaux), l’écriture « blanche » (Barthes), sans que soit atteinte pour autant la valeur littéraire de l’œuvre parue.
Les critères esthétiques sont plus profonds que cela en littérature, et les incorrections dans un ouvrage publié sont le fait de mauvais éditeurs. Quant aux auteurs qui font de l’auto-édition, des éditions ultérieures pourront toujours corriger les lacunes des éditions princeps, ces auteurs doivent en conséquence être considérés comme des héros de la littérature camerounaise, des gens qui ont su exister en dépit des institutions, et leurs livres sont bel et bien des livres, en français comme en anglais.
Qu’est-ce que c’est qu’un écrivain camerounais ?
Le statut d’écrivain, malheureusement, se passe de moins en moins d’un constat d’identité culturelle. C’est que l’on n’est pas écrivain au Cameroun comme on le serait en France. La part la plus importante de l’œuvre de Léopold Sedar Senghor a été écrite alors qu’il était président de la République. Doit-on dès lors s’empêcher de le considérer comme un écrivain parce que cela blesse les puristes ? La commune renommée peut rentrer en ligne de compte. Ateba Eyene s’est fait connaitre par ses publications davantage que par ses fonctions au ministère de la Culture, alors c’est un écrivain camerounais. Il n’existe pas au Cameroun une activité de critique littéraire telle que l’on puisse espérer qu’elle oriente la masse. Nous n’avons que des critiques occasionnels, qui agissent par amitié ou par haine.
Quant aux Camerounais qui publient en France, il ne faut pas tenir pour acquis que leurs œuvres font partie de la littérature camerounaise. Mongo Beti est présenté en France comme un auteur français d’origine camerounaise et c’est exact. Les œuvres qui sont produites en France par nos compatriotes ne ressortissent pas du « domaine étranger » de la France. Alors s’achemine-t-on vers des littératures à double nationalité ? La littérature camerounaise désigne des œuvres produites au Cameroun, comme la littérature française désigne des œuvres produites en France, sauf à imaginer une modulation exceptionnelle, des atteintes à l’orthodoxie, des sortes de dérogation dans la définition que l’on ferait de la littérature camerounaise. Quelle que soit la valeur d’un texte littéraire produit a l’extérieur de la France par un Français, celui-ci ne sera jamais nominé par les prix prestigieux récompensant la littérature française. Quelle que soit la nationalité d’un auteur publié en France, si ses textes sont bons, il est susceptible d’acquérir des prix dédiés aux auteurs français. De ce point de vue, Calixthe Beyala n’appartient pas plus à la littérature camerounaise qu’Amélie Nothomb n’appartient à la littérature belge ou Andrei Makine à la littérature russe.
Editeurs amateurs recherchent écrivains professionnels
Les publications du membre suppléant du comité central du RDPC n’entrent pas dans ce que l’on pourrait considérer comme littérature stricto sensu. Mais dans le fond, qui se soucie de littérature au Cameroun ? Marcellin Vounda Etoa défend son bifteck et fait désormais des « livres scolaires » son principal cheval de bataille, on voit bien à quel niveau il place la barre. Les éditions Clé veulent se spécialiser dans la mafia des manuels scolaires : la passion de la facilité nous perdra!
Marcellin Vounda Etoa, en tant que critique, ne vaut pas plus que Charles Ateba Eyene, adoubé comme écrivain par sa prolixité que soutiennent des succès de vente, qui ne tiennent pas simplement en des techniques de marchéage bien rodées. Sur la forme comme dans le fond, en tant qu’éditeur, Marcellin Vounda Etoa ne vole pas plus haut que l’auto-éditeur Charles Ateba Eyene. Enfin, en tant qu’enseignant d’édition, il est d’une inculture crasse.
Dans une démonstration improbable, l’enseignant d’édition a estimé que les éditeurs avaient le monopole de la production des livres. Pour lui il ne suffit pas qu’un texte soit « imprimé » pour que l’on en parle comme d’un livre. Voire! En 2012, à l’ère des tablettes numériques, les livres n’ont même plus besoin d’être imprimés pour être des livres. L’ancien promoteur du magazine Patrimoine s’est enfoncé en définissant, dans une surprenante attaque, le concept français d’édition. Il l’a opposé à la terminologie anglo-saxonne, qu’il ne maîtrisait manifestement pas. Vu qu’il a soutenu avec une souveraine assurance que la langue anglaise était plus précise, soi-disant parce qu’elle parle de print (sic) et editing (sic) au lieu que le français se contente du mot « édition ». Les bras m’en tombent!
De telles niaiseries seraient passées à n’importe qui d’autre, mais venant d’un éditeur, par ailleurs enseignant d’édition à l’ESSTIC, on croit halluciner. On a, comme Samuel Eto’o naguère, « honte d’être camerounais. » Allez dire, pour donner une chance à ses futurs étudiants, allez dire à monsieur Vounda Etoa que l’on parle, en anglais, de publishing et la langue française est bien précise qui distingue les activités d’impression, de publication et d’editing par exemple. Ce dernier anglicisme est utilisé dans le jargon de l’édition pour designer les corrections ortho-typographiques et la réécriture qui sont opérées sur certains textes. L’édition n’est donc pas comme il l’a prétendu le travail de relecture « ligne après ligne », ce n’est pas en tout cas exclusivement ni essentiellement cela.
L’édition est un processus qui va de la production du texte à la diffusion du livre, en passant par sa fabrication et sa publication. Et toutes les étapes peuvent être sous-traitées par exemple par des écrivains-conseils au niveau de la correction, par des éditeurs plus importants au niveau de la diffusion. Certains éditeurs, comme L’Harmattan, développent eux-mêmes de puissants réseaux de diffusion et distribution. Et ce travail est à la portée de tout Camerounais. Il suffit d’avoir les moyens de sa politique. Le livre est soumis à des formalités de dépôts (légal, judiciaire, administratif) et, par souci de référencement international, à l’obtention d’un numéro ISBN, que n’importe quel auteur peut valablement obtenir au ministère de la Culture, et puis c’est tout.
Editions Clé, Sopecam, etc., il faut nettoyer les écuries d’Augias
Ce n’est pas simplement en raison d’affinités électives avec Ferdinand Nana Payong que deux auteurs et demi sur quatre panelistes provenaient de la même maison d’édition : éditions du Schabel. Haman Mana, jeune éditeur, n’en est pas moins un vieux routier, il n’est pas docteur d’Etat, mais a quelque chose qui, pour la plupart des éditeurs camerounais, est complètement inconnue au bataillon : le flair.
On lui reproche de « mange[r] seul » (Joseph Antoine Bell), mais c’est une accusation universelle ça ; aux Etats-Unis, Stephen king avait lui aussi fini par se mettre à l’auto-édition. François Mitterrand estimait, dans une boutade, que le métier d’éditeur consiste à plumer des auteurs. Cela dit, que les éditeurs camerounais veuillent bien respecter les maigres droits qu’ils consentent à leurs auteurs, qu’ils ne viennent pas rogner sur leur portion congrue.
L’éditeur est un découvreur de talents, cela fait intimement partie de son job. Et une maison d’édition qui depuis plus de vingt ans n’a révélé aucun écrivain n’est mais alors pas du tout une maison d’édition. Elle doit se convertir à la vente des livres scolaires.




